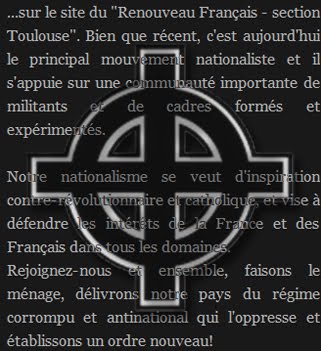Lors de notre réunion le vendredi 20 juin ayant pour thème « la place de l’Eglise dans un état nationaliste », un abbé est intervenu afin de nous expliquer pourquoi la religion constitue la colonne vertébrale d’un état et même plus largement d’une civilisation et sa place réelle dans ce même état.
Lors de notre réunion le vendredi 20 juin ayant pour thème « la place de l’Eglise dans un état nationaliste », un abbé est intervenu afin de nous expliquer pourquoi la religion constitue la colonne vertébrale d’un état et même plus largement d’une civilisation et sa place réelle dans ce même état.En effet, que l’on regarde, dans l’Antiquité, les civilisations grecque, romaine ou égyptienne: elles se sont construites autour d’une religion ; que l’on regarde, tout simplement la France jusqu’en 1789 : tout part de la religion (par exemple, le Roi reçoit son pouvoir de Dieu). Et cela s’explique simplement, par la nature de l’homme : chez l’homme, l’action la plus « noble » est celle de l’intelligence, l’action spirituelle (engagement, questions métaphysiques, etc.…) ; de même, la partie la plus haute d'un état, d'une civilisation sera la partie spirituelle. Or, de nos jours, la religion, et plus précisément la religion catholique, est dénigrée, bafouée. Après avoir montré la place essentielle et vitale de la religion dans l’état, nous allons la préciser.
Il faut tout d’abord faire la distinction entre deux puissances : la puissance ecclésiastique, qui s’occupe de tout ce qui a trait à Dieu, aux « choses divines », c’est le pouvoir intemporel, et la puissance civile qui s’occupe de tout ce qui concerne les hommes, les « choses humaines », c’est le pouvoir temporel. Chacune de ces puissances a une action différente de l’autre et agit dans une sphère différente.
Cependant, le pouvoir humain, s’il s’occupe de choses humaines, est issu de Dieu. « L’homme est né pour vivre en société », or une société a besoin d’un chef, et chacun de ses membres tend vers un but commun, il est donc nécessaire à toute société d’être régie par une autorité. Cette même autorité procède de la nature, qui a elle-même Dieu pour auteur. Par conséquent, « le pouvoir public ne peut venir que de Dieu ».
Certes composée d’hommes, l’Eglise est cependant surnaturelle et spirituelle, que ce soit pour la fin, l’objectif, ou pour les moyens employés afin d’y parvenir. Elle est donc différente de la société civile. Par ailleurs, elle est « juridiquement parfaite dans son genre », puisque auto-suffisante. « Comme la fin à laquelle tend l’Eglise est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l’emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur, ni assujetti au pouvoir civil».
La distinction entre les deux pouvoirs étant établie, il faut désormais regarder quels sont les devoirs religieux du pouvoir humain. Tout d’abord, la société politique doit « accomplir un par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l’unissent à Dieu », puisque c’est de Lui qu’est issu son autorité.
Ensuite, elle se doit de protéger et favoriser l’Eglise et de ne rien décider qui puisse lui nuire.
Enfin, la législation doit s’inspirer de la religion chrétienne, pour assurer « le bienfait d’une loi fondamentale de l’Etat qui s’oppose aux sains principes religieux et moraux » (Pie XII) aux générations présentes et futures.
Il y a toute fois des domaines qui nécessitent l’intervention des deux puissances, bien qu’à titres différents, par exemple la famille. Ce sont les domaines mixtes.
En conclusion, on notera deux citations importantes :
« Dans la constitution de l’Etat, telle que nous [Léon XIII] venons de l’exposer, le divin et l’humain sont délimités dans un ordre convenable, les droits des citoyens sont assurés et placés sous la protection des mêmes lois divines, naturelles et humaines ; les devoirs de chacun sont aussi sagement tracés que leur observance est prudemment sauvegardée »
« Quand l’empire et le sacerdoce vivent en bonne harmonie, le monde est bien gouverné, l’Eglise est florissante et féconde. Mais quand la discorde se met entre eux, non seulement les petites choses ne grandissent pas, mais les grandes elles-mêmes dépérissent misérablement »… (Yves de Chartres au pape Pascal II)Attention : tout ce qui est entre guillemet sans références est issu de l’encyclique de Léon XIII Immortale Dei (1885) sur laquelle s’est appuyé le père.