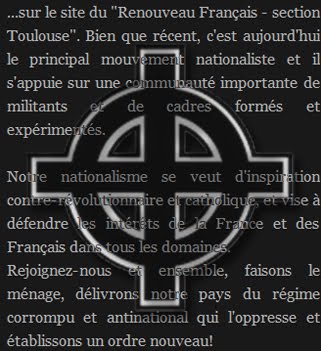Nous nous sommes dernièrement réunis sur le thème des Droits de l’Homme, dogme quasi incontesté dans nos sociétés et fondement de l’édifice juridique français, abordé ici sous un angle critique, et dans son aspect philosophique en particulier. Nous avons reproduit ici la structure détaillée de l’exposé:
I. / Les contradictions inhérentes à la Déclaration
A. Des failles et incohérences dans l'intitulé: "Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen."
Dissociation infondée entre homme et citoyen: qu’est-ce qu’un homme qui ne serait pas citoyen? Le concept de droit n’est envisageable que dans le cadre d’une société politique.
LE citoyen est un concept abstrait. Nulle part on n’a rencontré LA Cité en soi, il n’existe donc que des droits des citoyens au pluriel en fonction de l’époque, du pays, du régime considérés
B. « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il y a au contraire incompatibilité entre liberté et égalité : la liberté n’est pas innée mais acquise, elle est un combat, et tous ne combattent pas de la même manière. L’égalité des droits contrevient donc à la liberté des élites en instaurant un nivellement par le bas.
C. L'universalité de la notion des droits de l'Homme suppose la reconnaissance d’une nature humaine à statut de cause, or celle sur laquelle se fonde la Déclaration est fondamentalement subjectivité et liberté (l’homme n’est que ce qu’il se fait) donc négation de la nature humaine : dans de telles conditions impossible de légiférer dans l’universel.
D. Les droits de l’homme en conflit entre eux : droit à la vie contre droit à l’avortement, liberté sexuelle contre atteinte à la pudeur, liberté d’expression contre droit au respect de ses convictions religieuses, etc.…
II. / La philosophie qui sous-tend la Déclaration
A. J-J Rousseau et le contrat social.
1) Suppose que l’homme préexiste à la société et arrive dans la société avec ses droits. Société individualiste qui repose sur un droit subjectif et ne tient pas compte de la notion de justice
2) Équilibre fragile qui engendre un état de frustration perpétuelle
3) Réfutation : l’individu ne préexiste pas à la société, il y est d’emblée intégré dans la cellule de base de la société qu’est la famille puis dans la société politique. Il est donc débiteur d’une société de laquelle il reçoit tout. L’homme au sens plein du terme (intelligence, civilisation, valeurs, etc.…) n’est possible que dans la société. Voir les raisonnements de Maurras dans Mes idées politiques.
B. Le libéralisme philosophique
1) Tout doit céder le pas devant la liberté individuelle qui s’arrête là où commence celle des autres ; la liberté ainsi considérée est donc une faculté antisociale, liberté d’un homme limité à son individualité. Impossible sous peine d’introduire tension et conflit au cœur même de la nature humaine puisque l’homme est naturellement « animal politique »
2) Liberté comme absolu et bien suprême de l’homme. Confusion moyens-fin : la liberté, si elle est une condition du bonheur, ne fait pas le bonheur à elle seule, elle est un moyen de l’atteindre.
3) Saine conception de la liberté : faculté de faire le bien alors qu’on a la possibilité de faire le mal. Faculté subordonnée au vrai bien humain comme l’est la société, elle ne peut donc pas nuire à l’ordre social mais le favorise au contraire puisqu’elle poursuit le même but ultime.
C. Individualisme foncier
1) Chimère d’un égoïsme altruiste, ce serait en recherchant son bonheur individuel que chacun concourrait à l’harmonie du tout qu’est la société. Chez les anciens comme Aristote, c’est exactement le mouvement inverse : du bien commun à l’ensemble de la société recherché en tant que tel découle le bonheur particulier de chaque individu.
2) Pour remettre les choses à leur place, il n’y a pas subordination de la société à l’individu, mais subordination réciproque de l’individu et de la société : l’individu est subordonné à la société comme la partie au tout auquel elle appartient, mais le Bien Commun au service duquel est la société n’est pas un bien étranger aux individus, en ce sens la société est pour les individus. Personne individuelle et société sont toutes deux subordonnées à un même objet qui est la perfection humaine, le vrai bien humain.